
Osé l’Hypérion de Malis : Les voix de l’encre
Hypérion, d’après Friedrich Hölderlin, mise en scène Marie-José Malis

Quelque part au festival d’Avignon, il y a Marie-José Malis et son Hypérion. Une pièce ou un chant qui relève d’une lecture que l’on fait pas à pas et dont on aimerait qu’elle parvienne à l’oreille intérieure des estivaliers. Salle Benoit XII, rue des Teinturiers, une exigence rare donne à entendre Hyperion. Une “lecture-écriture” de Malis, comme l’aurait écrit Meschonnic, où la scène : agora d’un peuple mineur que sont les comédiens, s’attache à faire résonner l’entremêlement des voix célestes et terriennes. Là où “la raison pure”, dit Hölderlin, n’est rien sans le pneuma de l’esprit poétique. Là, dis-je, où un simple regard jeté à l’amour parfait provoque la plus totale désespérance, celle de Diotima, celle d’Hypérion… l’ermite de Grèce qui ne peut y échapper.
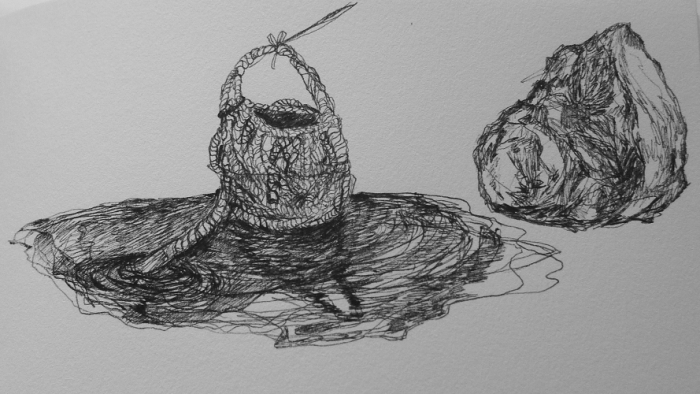
De la critique… Du critique
Loin de la place Sintigama et de Benaki, à la nuit tombée, marcher sur les chemins escarpés, parmi les oliviers noirs ventrus immobiles et les eucalyptus aux têtes fières, en contrebas de l’Acropole, entre l’agora : son rocher, et le souc : son agitation, ses senteurs, ses couleurs et ses artisans, les échoppes ouvertes sur les ruelles étroites, et la multitude… Avoir goûté la nuit ensuite, son silence vertigineux dans l’aplomb du ciel et l’aura des étoiles contrariées par les lumières électriques d’Athènes. Puis sentir la fraîcheur du matin, reconnaître le bruit sonore des grillons qui se mettent en formation et prennent le relai des chants grégoriens entendus, ici et là, dans les minuscules chapelles pierreuses à peine distinctes de la nature et de l’obscurité, au long de la nuit et au détour d’un sentier… Avoir senti, une nuit, la solitude et le recueillement, l’ermitage et la joie. Avoir éprouvé quelques pensées déliées du mouvement ordinaire de la vie. Avoir marché sans but, sans finalité et être saisi par les retrouvailles avec soi. Avoir ressenti qu’il est parfois donné de ne pas s’oublier soi-même. Avoir aimé ne rien voir, mais avoir trouvé quelques passages vers un monde intérieur. Avoir été troublé, enfin, par quelques heures au point de redouter le jour…
Et commençant par ces lignes de voyageurs, c’est moins un souvenir que le critique se permet de rappeler, qu’un voyage intérieur, le récit d’une intensité ou une sensation imprévisible et inattendue qui naquit et revint le hanter à la récitation de l’Hypérion de Marie-José Malis.
Pouvoir inéffable du théâtre qui, dès lors qu’il est l’objet d’un travail qui prend la forme d’une œuvre, met le spectateur au contact de forces et d’énergies supérieures. Il sera toujours possible, comme Emmanuel Levinas l’écrivait pour répondre à Sartre, de reprocher à ces lignes qu’elles ne disent rien de l’œuvre, que l’œuvre est muette, et de citer le philosophe encore : « qui a encore à dire quelque chose quand tout a été dit ? »[[Emmanuel Lévinas, « La réalité et son ombre », in Les Temps Modernes, n° 38, novembre 1948. Je cite : « qui a encore à dire quelque chose quand tout a été dit », ibid., p. 771.]]. Notre prétention ou notre prévention critique s’arrangera de ces paroles justes en rappelant que de toutes les manières, le discours critique, comme tous les autres discours sur l’Art, ne parle jamais que de l’effet de l’œuvre sur celui qui la croise, et non de l’œuvre d’art. En cela, le discours critique n’est pas autre chose qu’une écriture qui diffère, plus ou moins, le rapport intime qu’il entretient avec l’œuvre et permet de s’en rapprocher sans jamais l’atteindre.
En avoir la conscience permettrait sans doute à quelques pisses copie de pacotilles, quelques ruminants de la presse – juges à charge, censeurs d’une autre époque, commissaires politiques et autres petits inquisiteurs – de raturer/saturer leur billet d’humeur autrement, et d’éviter de « chier sur la tête » des créateurs comme Thomas Bernhard l’écrivait dans Le Neveu de Wittgenstein.
« Esprit critique es-tu là ? » demande-t-on à Avignon sans autre intelligence. Question péremptoire et grossière dont on mesure qu’elle pointe a priori une défaillance, mais surtout qu’elle fait également le procès d’une profession (on dit « journaliste culturelle ») qui ne renvoie à aucun métier, aucune pratique, aucune théorisation du geste critique, aucun rapport au théâtre sinon celui d’occuper gratuitement un siège en salle… et qu’elle a principalement à voir avec le jeu social. C’est-à-dire, pour qui l’ignore encore, à une conversation sur le théâtre, entre la poire et le fromage, qui sert à meubler les discussions mornes des vieux croutons sur le retour : reliefs d’intelligence mettant en accusation tout ce qui ne leur ressemble pas…
Et si le lecteur s’inquiéte des noms qui sont absents ici non par souci de préserver l’anonymat, mais plutôt par volonté d’éviter une publicité pour des produits périmés, qu’il consulte les blogs de ces adeptes du goût, qu’il se rende au kiosque ou écoute les émissions de radio comme le « casque et la chiurme », ou qu’il consulte la liste des membres syndiqués d’un nom qui est usurpé… A bonne entendeur salut, messieurs dames de la plume à quat’sous !
Hypérion vous était interdit, apprenez à choisir vos « spectacles », évitez-vous l’art et préférez-lui les produits culturels… et, s’il vous plait, épargnez-nous de commenter l’exigence en la mesurant à l’échelle de votre indigence.
Qu’avez-vous lu d’Hölderlin ? Y avez-vous consacré seulement quelques heures ? A défaut de ce récit épique, un poème vous a-t-il arrêté ? A ces questions, j’entends déjà votre réponse collégiale poussive qui commence par un « Ah », « Ah s’il faut avoir lu pour aller au théâtre », s’il faut être un « intellectuel »… ou plus sournoisement en prenant le ton de l’engagement « le théâtre est un art populaire… ces restrictions exclues le spectateur !»… Et ces premiers arguments convenus sont le reflet de vos écrits… Oui, il faut lire quand c’est nécessaire si l’on veut en parler, si l’on veut articuler le poème d’Hölderlin à la forme plastique que lui donne Malis… Comment juger d’une mise en scène de fragments sensibles sans connaître l’origine de ceux-ci ? Oui, il faut avoir aussi des qualités intellectuelles. C’est-à-dire avoir pris le temps d’apprendre autre chose que de livrer passage seulement à ses instincts et à ses besoins naturels. Et si l’intellect ne commande pas l’écriture, à part égale de l’émotion ressentie, il y a fort à parier que l’écriture critique ne soit plus la transformation d’une matière perçue, mais tout au plus la vibration anale d’un ego, tourné sur lui-même, qui ne produira que du « tout à l’égout ». Quant au « théâtre populaire » qui abrite votre flème, votre paresse, votre inquiétante suffisance à ne juger des choses qu’au regard d’une ignorance que vous habillez de tons convaincus et de jugements hatifs, ayez pour lui un peu d’exigence… Ce n’est pas le simplisme que vous lui prêtez. Ce n’est pas la communication à laquelle vous le renvoyez. Ce n’est pas l’accès libre et au plus grand nombre qui vous sert de paravent. Risquons une autre explication, entre autres. « Populaire », c’est un adjectif noble. Il désigne une forme de noblesse que l’esprit petit bourgeois (qui souhaite le contentement et le divertissement) ne peut finalement pas saisir… car « populaire » induit le manque. Le populaire a l’esprit noble et sait que de ce monde, il ne doit pas en attendre tout. Paradoxalement, ce savoir lui vaut, au populaire, d’avoir l’esprit ouvert et de prendre sans a priori ce qui se présente à lui. De prendre, dis-je, tout ce qui peut se substituer au manque initial… Ni bégueule, ni fine-bouche ou cul serré… Le populaire c’est un idéaliste, en définitive, capable de tout découvrir.
Quant à vous, vous me faites penser au petit marquis qui juge d’une pièce dans La critique de l’école des femmes… vous jugez et vous éructez, mais en vous méprenant sur les catégories qui vous permettent d’aiguiser le regard. On rirait presque des myopes que vous êtes, pas plus affranchis sur le lexique et le dictionnaire (où figure toute la poésie comme le prétendait Rimbaud), que sur l’art théâtral que vous confondez avec la satisfaction immédiate de vos instincts grégaires… Réactions de veuves endeuillées que vos petites phrases qui reviennent d’un papier à un autre…
Ah, pour finir et qui permettra de méditer… Ces quelques pensées de Pierre Paolo Pasolini, extraites de Manifeste pour un nouveau théâtre : « Le théâtre facile est objectivement bourgeois, le théâtre difficile est fait pour les élites bourgeoises cultivées ; le théâtre très difficile est le seul théâtre démocratique ».
L’Adresse de Malis
Une façade… un début de rue lépreuse, quelques enseignes en cyrillique, en arabe, en français… quelques mots, aussi, d’une langue internationale ou multinationale « Coca cola, Peugeot… », une porte qui ouvre sur l’ANPE ou un appart… Des portes de garages métalliques qui plus tard serviront de toile de fond à des revendications, sortes de tableaux de traits d’esprit incarnés en tags, « Etat Libre » pourra-t-on lire… Des rideaux de fer de commerces abandonnés ou lynchés par un système financier qui a étranglé un mode de vie… Au début de la rue, un bar au velum rouge délavé, quelques chaises à une terrasse… En argot, genre poétique cultivé par Antoine Blondin jumeau de la prose de Baudelaire, le café, le bar… se dit un « Sénat » (lieu où le monde est refait, défait, reconstruit, mais toujours pensé) et ceux qui le fréquentent forment non pas une horde de clients anonymes, mais des « sénateurs ». Ainsi, à la première image d’Hypérion, ce qui est à vue, c’est l’histoire de ces cafés (culottés par les ans et tenus par quelques figures reconnaissables), dans les vieilles cités. Et ce qui parvient, dès la première image, c’est le souvenir de l’Histoire de ces territoires d’agitation, de réunion, de contestation… Souvenir du Flore, celui des Deux Magots, celui du Chien qui fume… véritable agora et territoire d’exil d’intellectuels qui y orchestraient les débats, les conversations, le rythme des passions politiques.
Premières images, dis-je, qui forment une sorte d’anachronisme, soutenu, revendiqué qui sera augmenté quand la scène commence à parler la langue d’Hypérion. Et première pensée… : Marie-José Malis regarde la Grèce saignée, exsangue, brutalisée, enlevée à ses citoyens, au peuple mutilée, aujourd’hui, et sans doute trouve-t-elle, à raison, quelques échos contemporains dans les vers d’Hypérion qu’elle va faire donner en s’appropriant le poème en ces parties et non en son déroulement linéaire. Aux premiers mots qui se font entendre alors que Sylvia Etcheto, sobre et intense tout au long des 5 heures, se détache du groupe de comédiens que forme Hypérion, sur le thème musical de l’opinion publique composé par Charlie Chaplin, résonne alors une réflexion sur la nature de l’Etat. Non pas une définition, mais un rappel sur son étendue, ses constituants, ses devoirs, ses limites… « Tu concèdes à l’Etat, me semble-t-il, trop de pouvoir. Il n’a pas le droit d’exiger ce qu’il ne peut obtenir par la force ; or, on ne peut obtenir par la force ce que l’amour donne, ou l’esprit. Que l’Etat ne touche donc point à cela, sous peine que l’on ne cloue sa loi au pilori… ». Sur un ton à peine sentencieux, mais modelée sous la forme d’une évidence simple et déterminée, une parole retenue et articulée, ces quelques instants éphémères à l’oreille donneront longuement à penser. Et surtout, dans une intensité rare, alors que cette langue déjà lointaine se donne à entendre, c’est sa clarté fabuleuse et éclairante qui nous parvient. Tout comme nous interpellera chaque fragment d’Hypérion parce que Marie-José Malis aura travaillé l’Adresse.
Le « TU » augural prend ainsi tout son sens et c’est à chacun des membres de l’assemblée que forment les spectateurs que Malis prétend s’adresser au point de lui permettre de vivre dans l’intimité de cette langue et de ces pensées.
Travail sur l’Adresse qui va régler le mouvement des comédiens, leur déplacement sur ce territoire incertain, leur voix dans les limbes de la raison, leur souffle d’étonnement, de suffocation, leur geste non pas ralenti mais composé… Travail sur l’Adresse où chaque scène, mot, événement musical vient comme une caresse, tantôt ferme, tantôt douce, appuyer ce qui est inhérent à Hypérion : une forme de douceur, une forme de douleur… Une sorte de chant des doutes et des deuils coloré des accents de la vitalité et de l’espoir, fait de l’étoffe de l’idéal, ruiné par la maladresse des raisons que produit la pensée.
Etude de l’Adresse qui réduit la distance entre les acteurs et les spectateurs, et qu’entretient le travail lumière dont la répartition marque à peine les espaces scène/salle pour privilégier un territoire commun où la parole est le lieu d’un partage sensible.
Dans ce travail subtile où la parole est adressée, la distance reste pour autant de mise. Et si l’acteur vient en front de scène, ce n’est pas pour trouver un « contact » avec le spectateur, mais plutôt pour construire une forme de présence sentie, à travers le Dit et le corps jouant, en lieu et place du silence observé par la salle. Une tentative de trouver, en quelque sorte, une humilité commune.
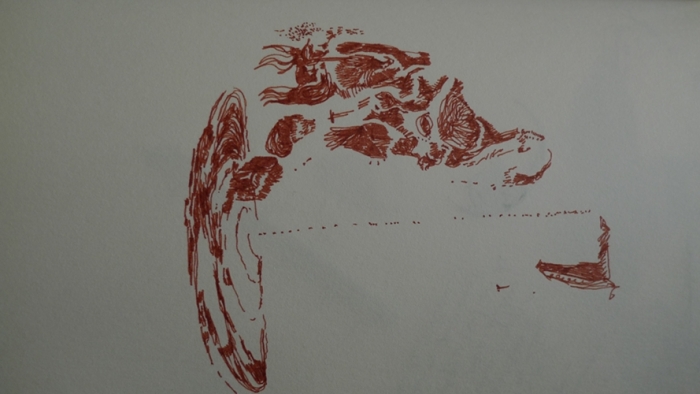
Hypérion lu… joué… entendu
Comment se saisir de ce récit où Hypérion s’entretient avec son ami Bellarmin, son amour Diotima, son frère d’arme Alabanda…? Quel chemin emprunter dans ce poème où Hypérion scrute la nature de l’Etat autant qu’il observe l’état de Nature ? Que faire de ces descriptions sensibles qui sont autant de chemins de croix pour celui qui est à la recherche d’un modèle idéal qui n’a d’autre contour que l’union de l’homme et du divin, dans un équilibre total où aucune hiérarchie ne viendrait diminuer l’un et l’autre ? Qu’écrire et garder, sur le plateau, de ces remarques qui portent sur la couleur d’un ciel, la densité d’une végétation, une pensée pour l’enfance, etc.
Maintes ouvertures se présentaient sans doute à Marie–José Malis pour suivre Hypérion, cet ermite sensible aux doutes, à l’amour unique, à la beauté et à la vérité en toutes choses, à la passion irrépressible, à l’esprit de tout comme à l’enfance naïve…
Dans cet espace scénique où quelques modules architecturaux aux murs se regardent comme les reliefs de temples sacrés ou comme des constructions modernes arrêtées par quelques promoteurs ruinés et crises foudroyantes… l’Hypérion de Marie-josé Malis aura pris le tour d’une architecture épique où le geste de la metteure en scène était archéologique et simultanément contemporain.
C’est-à-dire, et s’affranchissant du texte en son entier, Marie-José Malis aura privilégié quelques fondations du voyage d’Hypérion. Cet homme de l’avant, celui qui marche à la rencontre de ce qu’il cherche mais qui, s’il l’atteind, le perd… Elle aura tout d’abord évité l’écueil de l’incarnation de ce personnage par un seul acteur, lui préférant une forme chorale où les rôles sont interchangeables parce que tous les personnages sont liés par une quête identique, une représentation commune de ce que devrait être l’harmonie… C’est donc un chœur qui défiera la langue hölderlinienne et l’incertitude qui gouverne à l’ensemble du poème. Et d’ajouter que la mise en scène, alors, recueille les instants capitaux de ce récit où Hypérion cherche un âge d’or. Aux limites de l’Etat, à la preuve de l’amour, en passant par l’ascendance de l’Esprit et l’enfance naïve qui n’est qu’ouverture au monde… l’Hypérion de Malis se donnera comme un ensemble de strates et de couches successives où se donnent simultanément l’enthousiasme et la défaite, le regrêt et l’abnégation, la quête et la résignation, la résolution et l’erreur… parce qu’Hypérion, avant tout, est le signe d’un principe Incertitude qui règle tout le récit. C’est aussi, et Malis le divulgue avec humilité, une mémoire, une boîte à secret et à souvenir que le poème fouille et donne à reconnaître. Sur scène, un simple carton porté comme une offrande sacrée suffit à assembler cette communauté. C’est encore une course que celle d’Hypérion, un marathon dans les pensées humaines chaotiques, une sorte de conte des espérances qui finissent par se ternir, et qu’expriment le soupir d’un acteur, le soutien mutuel qui les oblige, l’alliance des esprits qu’ils forment au point de faire exister « une communauté d’esprit » («Kommunismus des Geistes » disait le trèfle du Neckar) promise à la dissolution qu’opère le temps, la rouille.
Et de regarder l’amour entre Diotima et Hypérion comme l’histoire d’un amour qui s’éteind et dont les braises n’en finissent pas de se regarder comme les lucioles pasoliennes…
Jamais texte ne fut joué avec autant de rigueur, d’exigence, de souci de l’adresse et de fidélité à l’idée de rendre ce qu’est un homme… « qu’est-ce que l’homme ? Comment se fait-il qu’existe dans le monde un pareil être, chaos de fermentation ou de pourriture, à l’image de l’arbre mort » écrit Hölderlin… Et Malis de se saisir de cette histoire qui en même temps qu’elle est un espoir est aussi un échec… et qu’elle fait entendre à partir de sa communauté d’acteur : ces voix de l’encre.
Au terme de la représentation, c’est un vers de fête de paix qui me revient et qui était à vivre, au dernier mot, au dernier souffle des acteurs… un vers éprouvé et enfin compris « Au retour du silence qu’une langue naisse ».
Et de nous permettre de citer Grüber qui, à ses acteurs, les remerciant, leur avouait : « je vous remercie, je crois que j’ai compris ».

