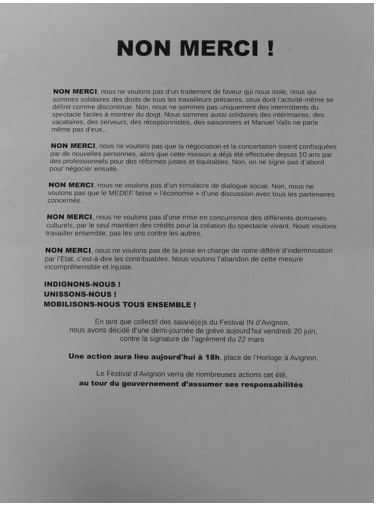
Ne rien oublier…
Quand j’étais Charles, texte et mise en scène de Fabrice Melquiot — Festival Off d’Avignon 2014
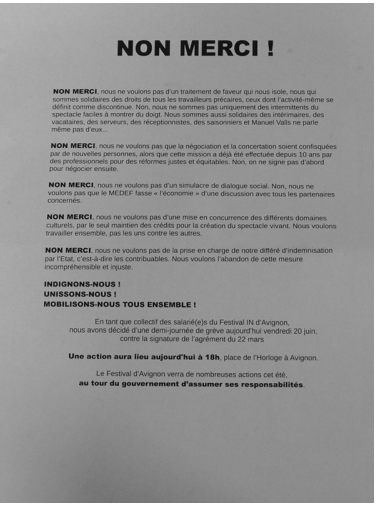

Dans le cadre du Festival off d’Avignon, le théâtre GiraSole présente Quand j’étais Charles, texte et mise en scène de Fabrice Melquiot et avec Vincent Garanger. Le désamour de l’une fait le malheur de l’autre. Ces histoires quotidiennes de tout le monde. Qui ne les oubliera jamais ?
Fabrice Melquiot, dont le nom n’est pas inconnu à tout le monde, a une carrière comme on s’imagine une carrière. À 29 ans, son premier texte est publié à l’Arche, une quarantaine suivront. Il reçoit des prix nationales et internationales. Ses pièces sont joués à la Comédie-Française. Auteur associé au CDN de Reims pendant six ans, ses pièces sont traduites dans nombreuses langues et montées dans nombreux autres pays. Puis, auteur associé au Théâtre de la Ville à Paris pendant trois ans pour être depuis 2012 à la direction du théâtre Am Stram Gram de Genève.
Vincent Garanger n’en a rien à envier. Après des formations au Conservatoire Municipal d’Anger, de l’ENSATT et du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et ayant travaillé avec Marguerite Duras, Alain Françon, Jacques Lassalle, Roger Planchon pour ne nommer que quelques uns, il est depuis 2009 co-directeur avec Pauline Sales du Préau, CDR de Basse-Normandie à Vire où Fabrice Melquiot produit quelques uns de ses spectacles.
Quand j’étais Charles met alors en scène Vincent Garanger qui joue devant une salle moitié vide un mec de la province, vendeur de machines agricoles, certes quelqu’un qu’on pourrait appeler un bon-vivant, mais dont ses rires trahissent son malaise. Il rit parce qu’il n’arrive pas à pleurer à part au moment : « Je ne suis plus moi-même. » pour effacer brusquement ses larmes pour retrouver la « force » de l’homme de la campagne. Plus lui-même, parce qu’il a perdu sa femme qui est partie avec quelqu’un d’autre pour finir seule parce que l’autre, au final, trouvait que « ça ne marchera pas ». Les femmes qui sont là pour reconstruire l’homme détruit par les sifflements de quadragénaires en fête du samedi soir au karaoké. Il gardera sa fierté de sa constance et sa fidélité même après les fantasmes d’une nuit d’orgie avec des infirmières avec des seins ballon et nues sous leurs chemises blanches d’aides soignantes. Ce ne sont pas elles qui le soigneront, mais c’est Aznavour qui le sauvera. Il lui écrit depuis des décennies sans réponse jusqu’à ce qu’une réponse lui arrive quand il est au plus bas de lui-même. Mais il ne lui adressera pas la parole. Il le regardera jusqu’à ce qu’il partira parce qu’il ne pourra pas faire cette rencontre sans le témoignage de son ex-femme, Maryse. Maryse auquel son dernier mot sera adressé : « Je n’ai rien oublié, je n’oublierai jamais. » Cet homme « d’obsession » qui voudrait « clouer le hasard sur son mur » aurait bien fait d’écouter un peu Deleuze pour reconnaître la force de l’oubli, mais tel n’est pas le sujet ici.
Vincent Garanger traverse les 1h25 de spectacle avec assurance en jouant tous les figures qui y apparaissent. En dialoguant avec sa femme et autres présences dans la salle. Twistant entre le show à mener au karaoké et les apartés de son intériorité, ses aveux de sa conscience de l’infidélité de sa femme, qu’il tente d’accepter par son amour inconditionnel. Cette solitude sur le plateau est en présence de masques naturalistes en sur-mesure des autres figures. Sa femme, Maryse, mais aussi son fils, « le blaireau », qui à la fin sera « grand et con », un marabout dont les annonces se trouvent régulièrement dans nos boites à lettre, guérisseur de tout, et Charles Aznavour auquel notre héro plaide son admiration inconditionnel, et de lui-même, vieux. À part ces masques, il y a une chaise au milieu, un micro qui servira à différencier les différentes prises de parole, un bol d’eau avec un poisson dedans qui servira à se nettoyer ou à tenter un suicide, des lumières qui illustreront les ambiances diverses du karaoké ou clarifieront les adresses de Vincent Garanger en éclairant le masque de sa femme absente à laquelle il parle.
J’ai reconnu un pêcheur breton que j’ai rencontré et qui n’arrivait qu’à rire des ses malheurs. Je reconnais cette réalité des gens simples. Je reconnais la fierté de régionalisme simpliste et l’admiration pour des gens médiatiques. Des gens qui disent : « Tout n’est pas possible. » qui est soit aussi la parole de psychanalystes, mais aussi le contraire d’une parole révolutionnaire. Des gens qui font évidemment ce qu’ils peuvent et dont on peut envier leurs soucis primaires. Primaires, non pas de manière péjoratif, mais comme les soucis premiers, fondamentales, qui nous constituent tous. Les soucis et la solitude dans laquelle ils les combattent. La jalousie, l’infidélité, la tentative d’une construction avec la contingence de la vie… Il se pose alors la question si le théâtre n’a pas autre chose à faire dans un temps de crise que de nous rappeler ce que tout le monde connaît et vit dans sa banale quotidienneté. Certes, on nous dit que les chansons sauvent la vie et qu’il faut chanter parce qu’il y a des vies à sauver. Mais si cela passe par imposer aux spectateurs de porter une bandelette avec le nom du spectacle au tour des poignets, si cela passe à leurs offrir un poiré et des gâteaux à la fin du spectacle, non pas dans une ambiance de chaleureuse rencontre, mais où l’on ait l’impression d’un procédure de marketing… si les chansons théâtrales demeurent des rappels de vieilles sentimentalités, même si ce sont les gens à la périphérie de la société du spectacle, victimes d’elle, …même si on nous raconte les malaises et les fêtes des gens de peu (Pierre Sansot), autant que leurs solitudes peuvent nous toucher… eh bien, alors rien. Rien à avancer la pensée, rien à ouvrir un horizon, rien à amener au politique. Rien pour les intermittents, rien contre un capitalisme qui reconstruit la guerre froide, rien contre une exploitation qui ne cesse de continuer, rien pour une expérience théâtrale nouvelle. Rien pour ne pas oublier un « théâtre populaire », les histoires éternelles du petit je. Ne pas oublier les sentiments qui sont éternellement les mêmes, qui fonctionnent éternellement de la même manière. Aznavour est vieux et ce théâtre avec lui.
